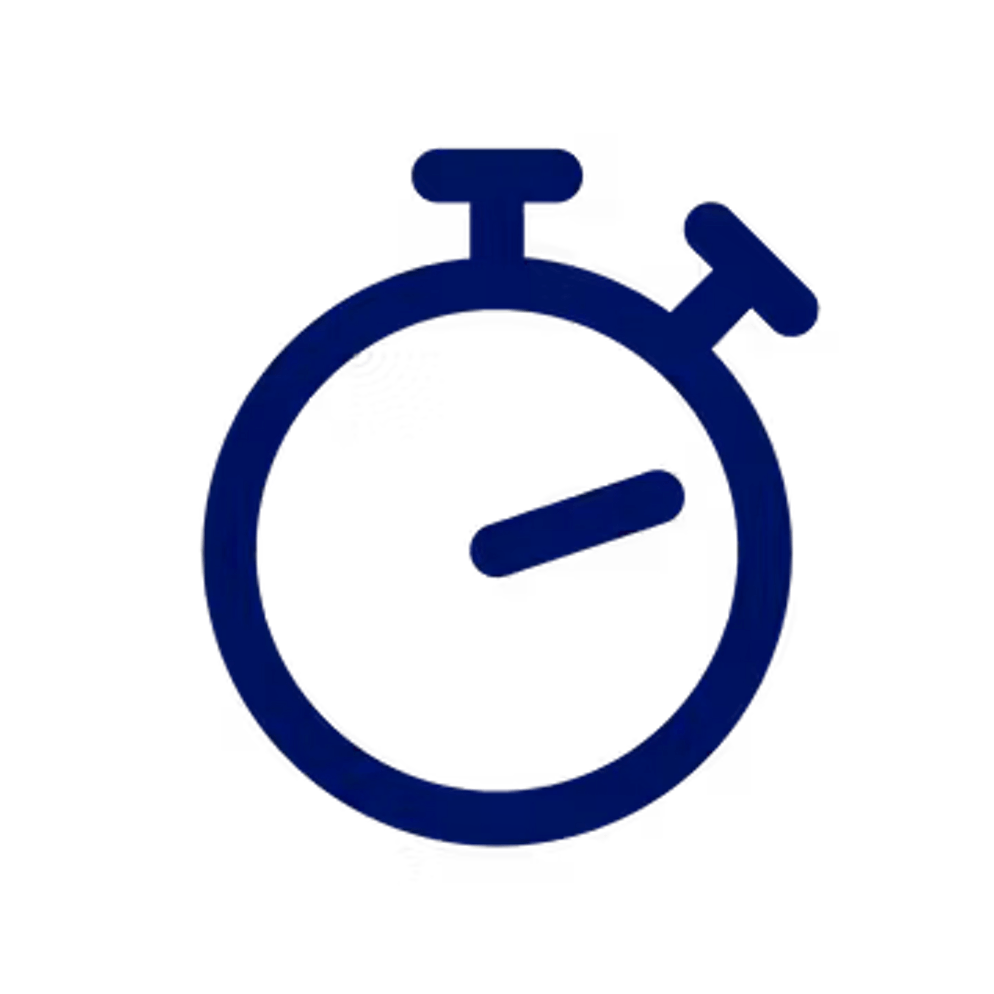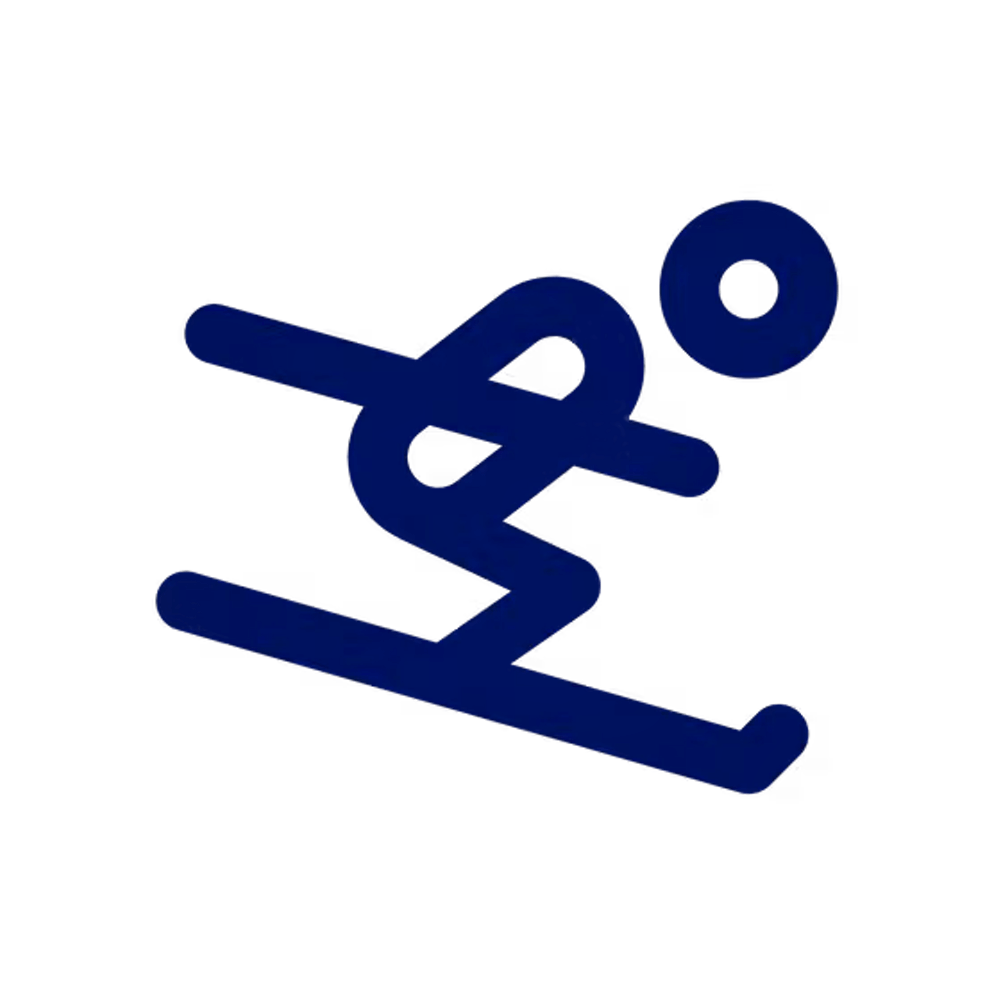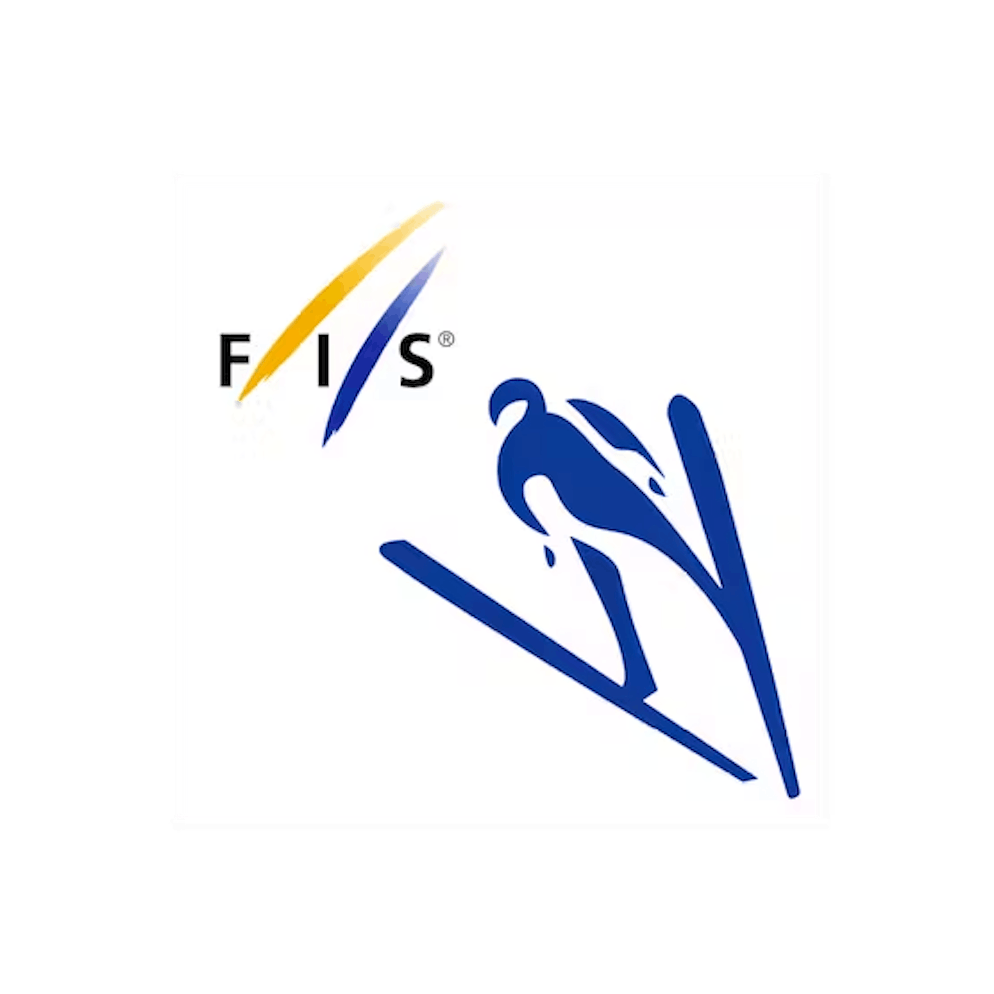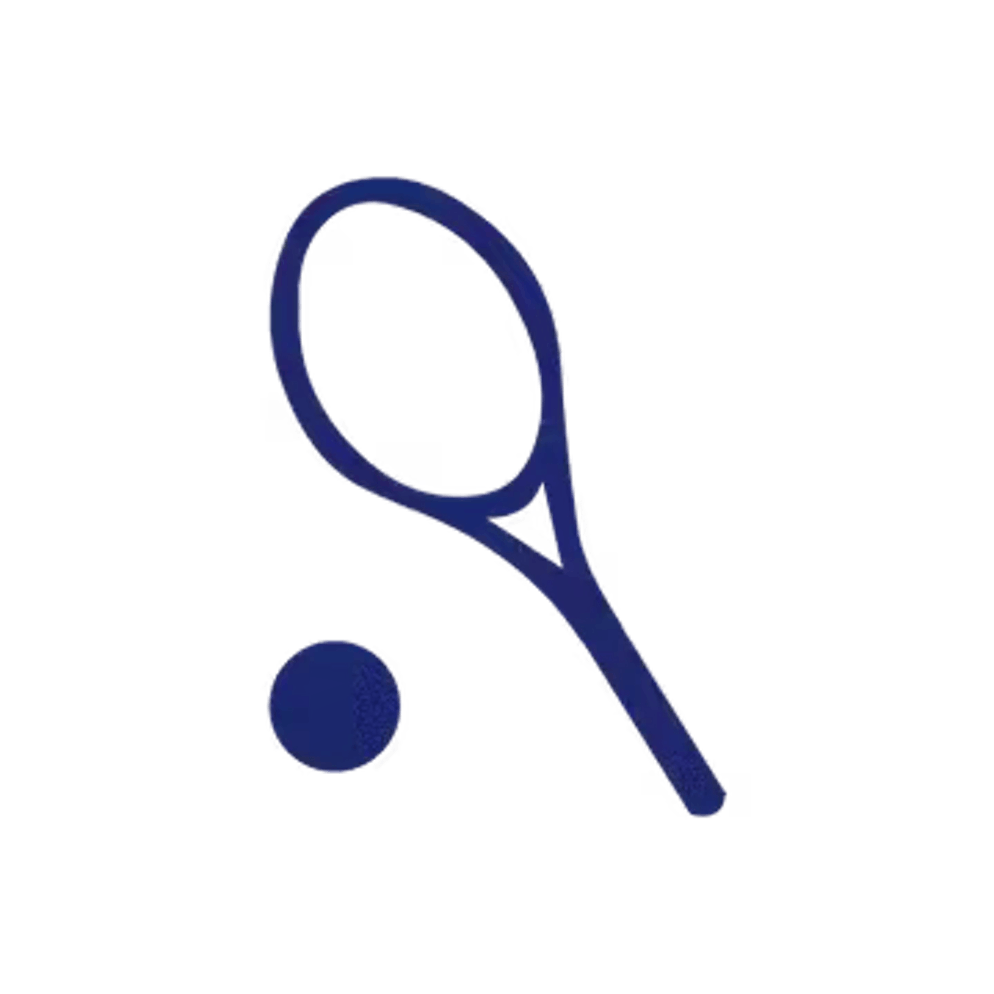Aperçu
Football en direct
Ligues
Super League
Aperçu
Sports d'hiver en direct
Résultats et classements FIS
Résultats et classements IBU
Aperçu
Hockey sur glace en direct
Résultats et tableau
Aperçu
Live-Tennis
Tournois
Résultats
Aperçu
Live Motorsport
Courses et classements
Live-Streams & Highlights
Services
Swisscom
- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Interview Gabrielle Deydier: «On me félicite pour avoir osé me mettre en maillot»
D'Aurélia Brégnac/AllTheContent
16.7.2020

«Je vivais mal aussi d’être une statistique, et cela me faisait culpabiliser.»
Photo: Bangumi/Arte

«Lors d’une soirée, j’avais parlé de grossophobie, et personne ne savait ce que c’était.»
Photo: Bangumi/Arte

Le mot «grossophobie» vient tout juste d’entrer dans le dictionnaire.
Photo: Bangumi/Arte

«L’idée était en fait de faire une enquête sur la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je ne voulais pas non plus qu’on croie que je revendique une identité par rapport à ça»
Photo: Bangumi/Arte

«On me voit comme la nana qui a été victime de grossophobie, et moins comme la nana qui travaille ce sujet»
Photo: Bangumi/Arte

«Ce qui ressort le plus clairement, ce sont les inégalités d’accès à l’emploi.»
Photo: Bangumi/Arte

«il n’y a pas de raison qu’il y ait de normes de beauté, qu’on souffre de fausses représentations.»
Photo: Bangumi/Arte

«Les statistiques montrent bien qu’il n’y a que 6% de femmes qui s’habillent en 36, et que plus de la moitié des femmes s’habillent en 42 et plus.»
Photo: Bangumi/Arte

«J’ai l’impression que c’est devenu un discours, une injonction à devoir célébrer son corps.»
Photo: Bangumi/Arte

«Qu’on me trouve belle dans la rue, chez le boulanger, au cinéma… je m’en fous en fait.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je pense qu’on doit s’émanciper des diktats.»
Photo: Bangumi/Arte

«Il y a des discours qui condamnent le seul fait de parler du poids comme étant de la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je n’ai eu quasiment que des jobs étudiants.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je vivais mal aussi d’être une statistique, et cela me faisait culpabiliser.»
Photo: Bangumi/Arte

«Lors d’une soirée, j’avais parlé de grossophobie, et personne ne savait ce que c’était.»
Photo: Bangumi/Arte

Le mot «grossophobie» vient tout juste d’entrer dans le dictionnaire.
Photo: Bangumi/Arte

«L’idée était en fait de faire une enquête sur la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je ne voulais pas non plus qu’on croie que je revendique une identité par rapport à ça»
Photo: Bangumi/Arte

«On me voit comme la nana qui a été victime de grossophobie, et moins comme la nana qui travaille ce sujet»
Photo: Bangumi/Arte

«Ce qui ressort le plus clairement, ce sont les inégalités d’accès à l’emploi.»
Photo: Bangumi/Arte

«il n’y a pas de raison qu’il y ait de normes de beauté, qu’on souffre de fausses représentations.»
Photo: Bangumi/Arte

«Les statistiques montrent bien qu’il n’y a que 6% de femmes qui s’habillent en 36, et que plus de la moitié des femmes s’habillent en 42 et plus.»
Photo: Bangumi/Arte

«J’ai l’impression que c’est devenu un discours, une injonction à devoir célébrer son corps.»
Photo: Bangumi/Arte

«Qu’on me trouve belle dans la rue, chez le boulanger, au cinéma… je m’en fous en fait.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je pense qu’on doit s’émanciper des diktats.»
Photo: Bangumi/Arte

«Il y a des discours qui condamnent le seul fait de parler du poids comme étant de la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je n’ai eu quasiment que des jobs étudiants.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je vivais mal aussi d’être une statistique, et cela me faisait culpabiliser.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je vivais mal aussi d’être une statistique, et cela me faisait culpabiliser.»
Photo: Bangumi/Arte

«Lors d’une soirée, j’avais parlé de grossophobie, et personne ne savait ce que c’était.»
Photo: Bangumi/Arte

Le mot «grossophobie» vient tout juste d’entrer dans le dictionnaire.
Photo: Bangumi/Arte

«L’idée était en fait de faire une enquête sur la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je ne voulais pas non plus qu’on croie que je revendique une identité par rapport à ça»
Photo: Bangumi/Arte

«On me voit comme la nana qui a été victime de grossophobie, et moins comme la nana qui travaille ce sujet»
Photo: Bangumi/Arte

«Ce qui ressort le plus clairement, ce sont les inégalités d’accès à l’emploi.»
Photo: Bangumi/Arte

«il n’y a pas de raison qu’il y ait de normes de beauté, qu’on souffre de fausses représentations.»
Photo: Bangumi/Arte

«Les statistiques montrent bien qu’il n’y a que 6% de femmes qui s’habillent en 36, et que plus de la moitié des femmes s’habillent en 42 et plus.»
Photo: Bangumi/Arte

«J’ai l’impression que c’est devenu un discours, une injonction à devoir célébrer son corps.»
Photo: Bangumi/Arte

«Qu’on me trouve belle dans la rue, chez le boulanger, au cinéma… je m’en fous en fait.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je pense qu’on doit s’émanciper des diktats.»
Photo: Bangumi/Arte

«Il y a des discours qui condamnent le seul fait de parler du poids comme étant de la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je n’ai eu quasiment que des jobs étudiants.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je vivais mal aussi d’être une statistique, et cela me faisait culpabiliser.»
Photo: Bangumi/Arte

«Lors d’une soirée, j’avais parlé de grossophobie, et personne ne savait ce que c’était.»
Photo: Bangumi/Arte

Le mot «grossophobie» vient tout juste d’entrer dans le dictionnaire.
Photo: Bangumi/Arte

«L’idée était en fait de faire une enquête sur la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je ne voulais pas non plus qu’on croie que je revendique une identité par rapport à ça»
Photo: Bangumi/Arte

«On me voit comme la nana qui a été victime de grossophobie, et moins comme la nana qui travaille ce sujet»
Photo: Bangumi/Arte

«Ce qui ressort le plus clairement, ce sont les inégalités d’accès à l’emploi.»
Photo: Bangumi/Arte

«il n’y a pas de raison qu’il y ait de normes de beauté, qu’on souffre de fausses représentations.»
Photo: Bangumi/Arte

«Les statistiques montrent bien qu’il n’y a que 6% de femmes qui s’habillent en 36, et que plus de la moitié des femmes s’habillent en 42 et plus.»
Photo: Bangumi/Arte

«J’ai l’impression que c’est devenu un discours, une injonction à devoir célébrer son corps.»
Photo: Bangumi/Arte

«Qu’on me trouve belle dans la rue, chez le boulanger, au cinéma… je m’en fous en fait.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je pense qu’on doit s’émanciper des diktats.»
Photo: Bangumi/Arte

«Il y a des discours qui condamnent le seul fait de parler du poids comme étant de la grossophobie.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je n’ai eu quasiment que des jobs étudiants.»
Photo: Bangumi/Arte

«Je vivais mal aussi d’être une statistique, et cela me faisait culpabiliser.»
Photo: Bangumi/Arte
Le mot «grossophobie» vient tout juste d’entrer dans le dictionnaire. Sa définition selon «Le Petit Robert», c’est «l’attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids». Un rejet qui est, aujourd’hui, progressivement mis au jour, sous l’impulsion de personnes ayant décidé de se battre contre les préjugés et leurs conséquences sociales.
C’est le cas de Gabrielle Deydier, auteure et documentariste qui, elle-même atteinte d’obésité, s’est lancé le défi de dénoncer une réalité jusqu’ici occultée. Un livre et un documentaire plus tard, les résultats semblent être encourageants même si, selon elle, il reste beaucoup de chemin à parcourir…
Nous avons rencontré cette jeune femme qui ne souhaite pas faire de son cas une généralité mais s’appuie, avec pragmatisme et objectivité, sur des données, des témoignages et des études qui viennent corroborer son histoire personnelle. Une histoire faite de vexations parfois, et notamment dans les domaines professionnel et médical. Entretien.
Vous êtes l’auteure du livre «On ne naît pas grosse» (Editions Goutte d’Or) publié en 2017 et du documentaire «On achève bien les gros» diffusé cette année sur Arte. Pourquoi avez-vous décidé de témoigner?
Pour moi, l’idée n’était pas de témoigner, mais plutôt de travailler ce sujet. Au départ, ce sont des amis qui montaient une maison d’édition qui m’ont proposé d’écrire. Lors d’une soirée, j’avais parlé de grossophobie, et personne ne savait ce que c’était. Donc mes amis, qui sont aussi mes éditeurs, m’ont demandé si je voulais traiter le sujet. A la base, je n’étais pas convaincue de le faire…
«On me voit comme la nana qui a été victime de grossophobie, et moins comme la nana qui travaille ce sujet…»
Pourquoi?
J’avais plein de craintes, en fait. Et notamment, d’être essentialisée comme «grosse». C’était quelque chose que je ne voulais pas du tout. Je ne voulais pas non plus qu’on croie que je revendique une identité par rapport à ça, que je me place en porte-parole des gros. Je ne voulais pas du tout de ça. L’idée était en fait de faire une enquête sur la grossophobie. Si j’avais pu éviter de parler de moi, je l’aurais fait. D’ailleurs, dans la première version du manuscrit, je n’en parlais absolument pas. J’étais très factuelle. Mes éditeurs m’ont dit que plus j’irais dans l’intime et plus les gens seraient susceptibles de lire. Alors c’est parti en double enquête: comment je me sens en tant que femme grosse, comment je vis et comment les gros vivent dans la société.
Mais vous êtes tout de même devenue une porte-parole de la grossophobie, en quelque sorte… Vous le vivez comment?
Je le vis pas très bien en fait. Je le comprends mais j’ai l’impression qu’on porte un peu un regard déformé sur mon travail. Du coup, on me voit comme la nana qui a été victime de grossophobie, et moins comme la nana qui travaille ce sujet…
On vous enferme un peu dans un stéréotype ou une position de victime?
Oui, alors que pour moi ce n’est pas une plainte. Il y a une situation injuste et il se trouve que je connais cette situation. C’est plutôt une immersion. Je voulais exposer les difficultés que j’ai rencontrées, puis montrer que, dans la société, il y a d’autres gros et les statistiques nous disent qu’ils rencontrent certaines difficultés. Je veux montrer le matériau, les données, puis les gens en font ce qu’ils veulent.
Qu’avez-vous conclu de cette enquête? Etre obèse aujourd’hui, dans notre société occidentale, en quoi cela impacte-t-il la vie des personnes concernées?
Ce qui ressort le plus clairement, ce sont les inégalités d’accès à l’emploi. Ce ne sont pas des histoires de «body positive», d’esthétique, de «je me sens belle» auxquelles je suis moins sensible…
«Il n’y a que 6% de femmes qui s’habillent en 36»
Justement, que pensez-vous du mouvement «body positive», qui promeut l’acceptation du corps tel qu’il est, et qui prend actuellement beaucoup d’ampleur sur les réseaux sociaux? Fait-il avancer les mentalités?
En fait, je suis assez mitigée sur le sujet. A l’origine, c’est un mouvement qui venait des grosses, justement. Ça a tellement bien marché que tout le monde s’en est plus ou moins emparé. Il y a bien sûr des choses très importantes dans ce discours. Par exemple, qu’il n’y a pas de raison qu’il y ait de normes de beauté, qu’on souffre de fausses représentations. La réalité, c’est plutôt qu’on nous a habitués à croire que la norme, c’était une minorité de personnes.
Les statistiques montrent bien qu’il n’y a que 6% de femmes qui s’habillent en 36, et que plus de la moitié des femmes s’habillent en 42 et plus. Au-delà du surpoids, des personnes qui ont été brûlées ou handicapées s’exposent sur les réseaux sociaux… Quand c’est ça le «body positive», alors ok. Sauf que j’ai l’impression que c’est devenu un discours, une injonction à devoir célébrer son corps. A devoir à tout prix chérir ce corps et l’aimer. Ça me dérange un peu parce que j’ai aussi le droit d’en avoir rien à faire. On n’est pas obligé de se demander tous les jours si on est beau, si on ne l’est pas…
Il y a des moments de ma vie où j’ai envie qu’on me trouve belle: quand j’ai envie de séduire quelqu’un qui me plaît. Mais qu’on me trouve belle dans la rue, chez le boulanger, au cinéma… je m’en fous en fait. C’est quand même une sorte d’injonction du «trouve-toi beau». La victoire, ce serait plutôt de ne rien en avoir à faire. Il y a quelque chose d’hyper narcissique dans cette glorification de la beauté. Ça me dépasse un peu. Le point positif étant encore que ça donne de la visibilité à des corps qui ne sont pas normés.
On remarque que la publicité et les marques font de plus en plus appel à des personnes de taille normale, corpulentes ou en surpoids pour les représenter. Est-ce avant tout un argument marketing ou la preuve d’une prise de conscience que les normes ne correspondent pas à la réalité?
Oui, c’est une bonne chose! Et ça ne me dérange pas si c’est du marketing. Je sais qu’il y a des gens à qui ça peut poser des problèmes moraux que les marques fassent ça. Peu importe la raison pour laquelle la marque décide de s’emparer du sujet. C’est le résultat qui compte. Je n’ai pas envie de mettre de la morale où il n’y en a pas en fait. On a récemment vu une grande marque de sport mettre en avant une yogi Afro-Américaine obèse, Jessamyn Stanley, pour une pub de brassière. Je suis contente de ça. Que ce soit des corps de la vie quotidienne ou non. Je pense qu’on doit s’émanciper des diktats.
«Ce qui me pose problème, c’est lorsque je viens pour une otite et que l’on me pèse avant de regarder mon oreille»
Plus on est gros et plus le corps médical met en garde contre les risques de maladies liées au surpoids. L’obésité touchant de plus en plus de personnes, est-ce que l’acceptation, voire la revendication de sa corpulence peuvent représenter un problème?
Pour le coup, je n’ai pas de problème à ce que les médecins fassent leur boulot de médecin en parlant des dangers du surpoids, en faisant de la prévention… En revanche, ce qui me pose problème, c’est lorsque je viens pour une otite et que l’on me pèse avant de regarder mon oreille.
A l’inverse, il y a des discours qui condamnent le seul fait de parler du poids comme étant de la grossophobie. Mais honnêtement, c’est un peu n’importe quoi. Je n’ai pas de problème à parler de mon poids avec ma généraliste, à mettre des choses en place avec elle. J’en aurais si elle m’en parlait à chaque fois que j’allais la voir.
Le problème, c’est quand il y a des médecins qui sont maltraitants. Si c’est leur seul discours, alors on n’y va plus. Si vous avez dit non à la chirurgie et, qu’à chaque fois que vous le voyez il vous parle de chirurgie, ça ne donne plus envie d’y retourner. Mais évidemment, je n’ai pas de problème avec la prévention contre l’obésité. C’est important, et notamment chez les enfants. Ce sont des vraies questions de santé publique à se poser. Il ne faut pas tout confondre et voir le mal partout…
«On se retrouve avec des grosses qui n’ont pas accès à la contraception...»
A côté de ça, il y a des choses qui sont réellement violentes, chez certains gynécos. Cette spécialité a la palme d’or du manque de bienveillance. On se retrouve avec des grosses qui n’ont pas accès à la contraception, découvrent trop tard qu’elles sont enceintes ou encore, qui souhaiteraient tomber enceintes, mais à qui on dit que ce n’est pas possible à cause de leur poids. Il y a de vraies maltraitances du fait du surpoids. Se faire par exemple engueuler par un médecin parce qu’il n’arrive pas à prendre votre tension… C’est peut-être aussi au médecin de s’équiper, étant donné le nombre de personnes concernées.
Personnellement, avez-vous réussi avec l’âge à surmonter les traumatismes vécus plus jeune. Et aujourd’hui, les vexations sont-elles toujours aussi fréquentes et ont-elles moins d’impact sur vous?
Les périodes qui ont été le plus violentes pour moi ont été l’adolescence, mais surtout ma tentative d’entrée sur le marché du travail. Je n’ai eu quasiment que des jobs étudiants. Pendant longtemps je refusais l’idée que cela soit dû à ma corpulence.
Venant d’un quartier populaire, ces histoires de déterminismes sociaux, je ne voulais pas en entendre parler. J’étais une enfant qui a toujours bien travaillé à l’école, et je pensais que ça faisait la différence. Avec mes copains du quartier, je refusais de croire que le racisme puisse par exemple changer la donne. Même gamine, j’avais ce discours très républicain… Quand j’étais à la fac, j’étais super active, volontaire et impliquée, mon poids ne posait pas problème. La limite est arrivée quand il a fallu trouver des stages. Et même à cette époque, je refusais de croire que c’était par rapport à ça.
«Il ne faut pas dire aux gens que leur poids est une limite.»
Il ne faut pas dire aux gens que leur poids est une limite. Évidemment, c’est une limite pour être pompier, je suis pas non plus un Bisounours. En même temps, je ne pourrais pas non plus être astronaute ou chirurgienne, et ce n’est pas en raison de mon poids… Je refusais d’entendre parler des déterminismes et des statistiques. Et puis, je suis sortie du déni quand j’ai lu les travaux de Jean-François Amadieu (un sociologue français spécialiste des relations sociales au travail et des déterminants physiques de la sélection sociale, ndlr).
Quand il fait l’expérience de grossir les candidats sur leur photo de CV, fait des testings, et que le processus de recrutement n’est pas le même… Et ce chercheur ne fait pourtant pas partie de la «team» victimaire. Je vivais mal aussi d’être une statistique, et cela me faisait culpabiliser. Je me disais «tu le mérites, t’as qu’à pas être grosse»…
Quel message voudriez-vous faire passer aux personnes qui se sentent stigmatisées?
C’est difficile…. J’aimerais tellement que les gens se libèrent du regard des autres, qu’ils arrêtent de s’empêcher à cause des jugements. Ça fait un peu «cucul» de dire ça comme ça. Mais j’ai envie de leur dire «imposez-vous», «arrêtez d’être polis», «soyez là»… Je me suis aussi rendue compte que si ces regards et ces discriminations existent bien, j’avais aussi donné trop d’importance à tout ça. Pourquoi mettre sa valeur dans le regard de l’autre, en fait?
«Je voudrais juste que la question du poids ne soit plus centrale.»
Etes-vous confiante sur l’avenir?
Je ne sais pas. J’ai aussi peur d’une société de quotas, qui se fracture. Je ne veux pas rentrer dans des logiques de discrimination positive. Je voudrais juste que la question du poids ne soit plus centrale. Qu’elle soit centrale pour soi et pour sa santé, mais pas pour les autres.
Allez-vous poursuivre votre combat dans les médias, et cela a-t-il déjà de l’impact?
J’ai l’impression que ça crée du débat dans les médias et qu’aujourd’hui, la question se pose, que tout le monde a acquis cette notion de grossophobie. En tous cas, chez les journalistes et dans les médias. Ce qui n’est clairement pas encore le cas au quotidien. Mais c’est normal car c’est encore émergent. Des gens regardent ça de très loin et avec appréhension. Quand je vois que certaines personnes qui ont vu le documentaire me félicitent non pas pour mon récit personnel mais pour avoir eu le courage de me mettre en maillot. Alors je me dis: «si on en n’est que là…».
«Il y a des gens qui me félicitent pour avoir osé me mettre en maillot.»
Ça vous vexe?
Oui, ça me vexe. J’ai énormément de retours sur les réseaux sociaux. Pour l’essentiel, les gens me disent merci, que c’est bien de prendre la parole, que ça leur a ouvert les yeux… mais il y a aussi des gens qui me félicitent pour avoir osé me mettre en maillot. Je ne me sens pas courageuse, même d’être allée aussi loin dans la transparence de mon rapport au corps. De manière générale, je ne lis pas les commentaires. Je n’avais pas envie de me charger de tout ça. Je la connais, ma réalité. Je n’ai pas besoin de lire de la haine en plus. Je m’en suis déjà libérée dans mon quotidien. Alors, c’est leur problème à eux. Là où ça pose problème, c’est quand on ne veut pas m’embaucher ou me soigner parce que je suis grosse.
Actuellement, vous préparez un nouveau projet dans les médias? Un livre, un documentaire, une émission?
Une émission? Alors ça pourquoi pas, j’aimerais bien (rires)… Je suis en train de finir mon roman. Ensuite, j’enchaîne avec un deuxième livre parce que j’ai pris beaucoup de retard. Et surtout, j’ai envie de faire de ce roman «Métabo» une série ou un long-métrage.
De quoi cela parle-t-il?
C’est en fait une dystopie, où les gros sont devenus les gens à abattre. C’est une société où l’obésité est interdite. Ensuite, mon autre roman, lui, n’aura rien à voir avec la grossophobie. Il s’appelle «Supernova» et parle d’une pauvre qui réussit dans le monde de l’édition et se trouve propulsée de sa campagne dans le Sud à cette vie de parisienne bourgeoise.
Est-ce que c’est un peu autobiographique?
En partie oui. Mais ce n’est pas vraiment mon histoire. C’est une immersion dans une classe sociale qui n’est pas la sienne. C’est un livre plutôt drôle et un thriller en même temps…
Pour en savoir plus:
- Documentaire «On achève bien les gros», de Gabrielle Deydier, Valentine Oberti et Laurent Follea, Bangumi Production, à voir sur Arte jusqu’au 16 août
- Livre «On ne naît pas grosse» (2017), Editions Goutte d’Or, disponible en édition de poche le 20 août prochain.