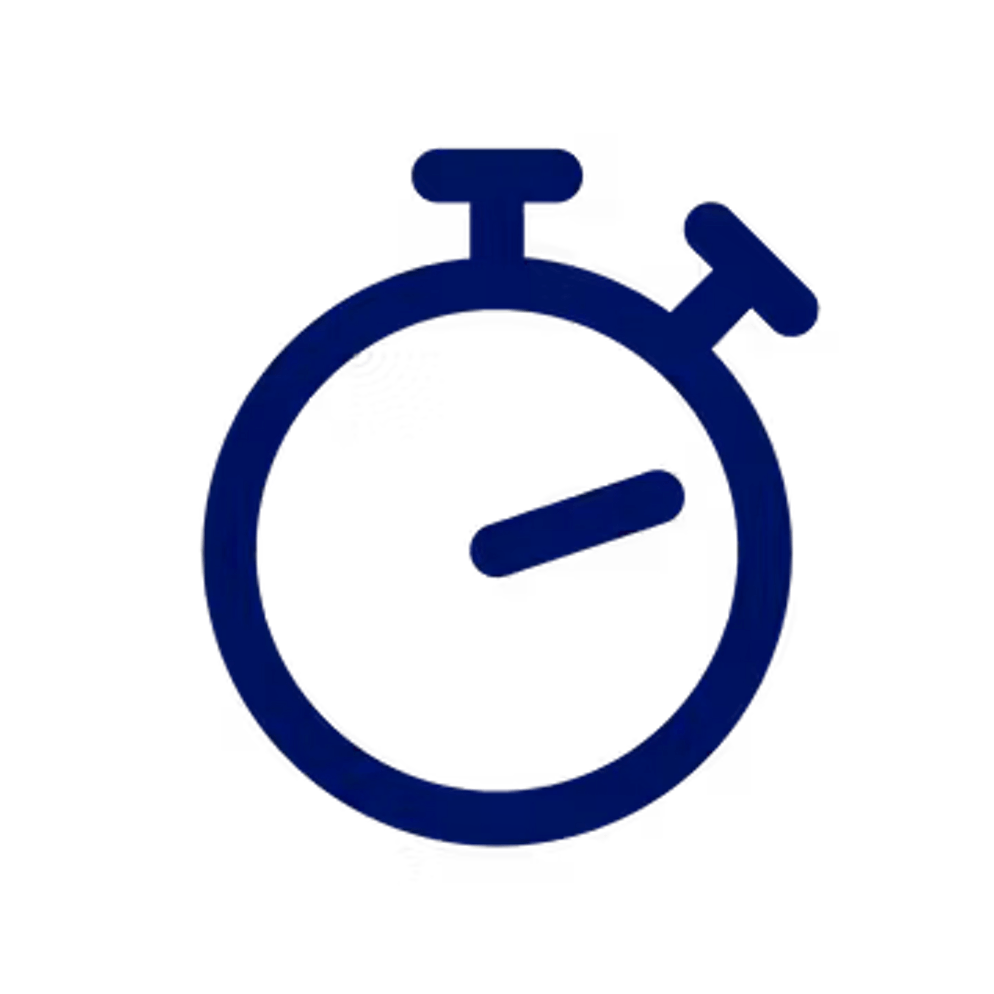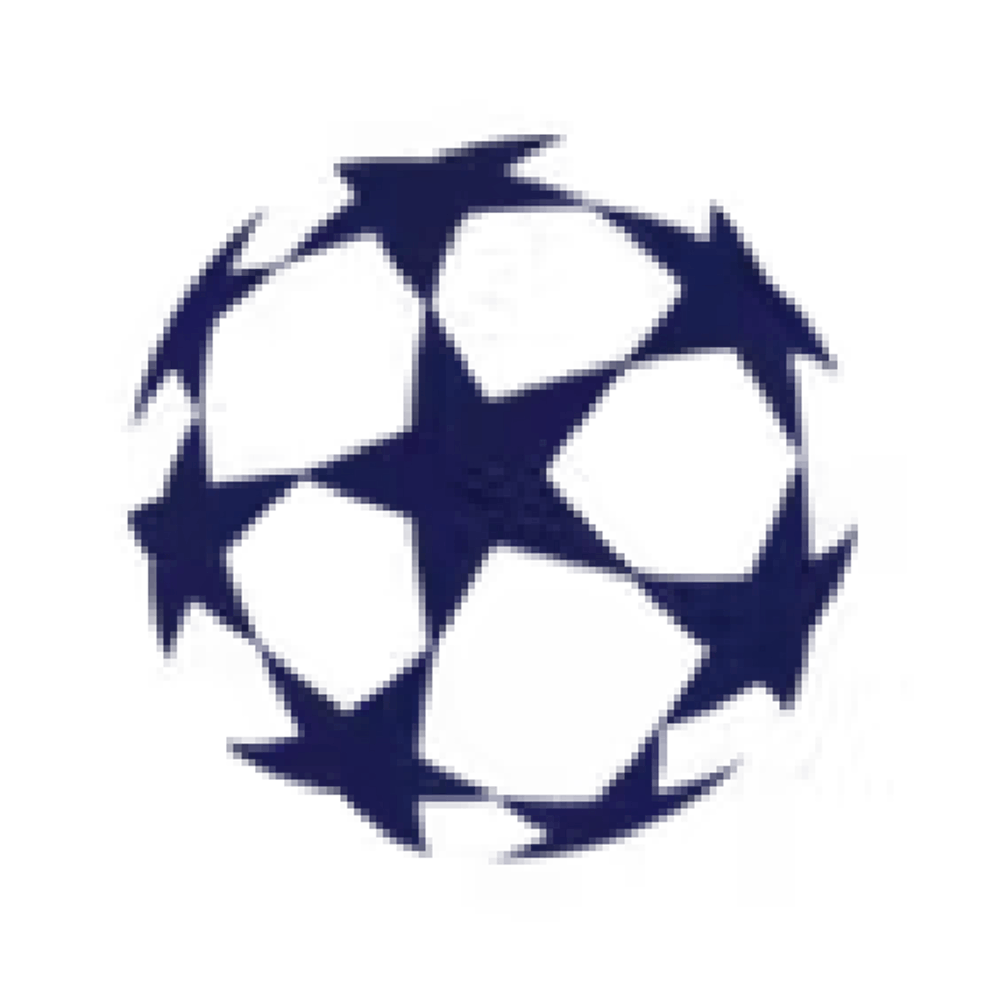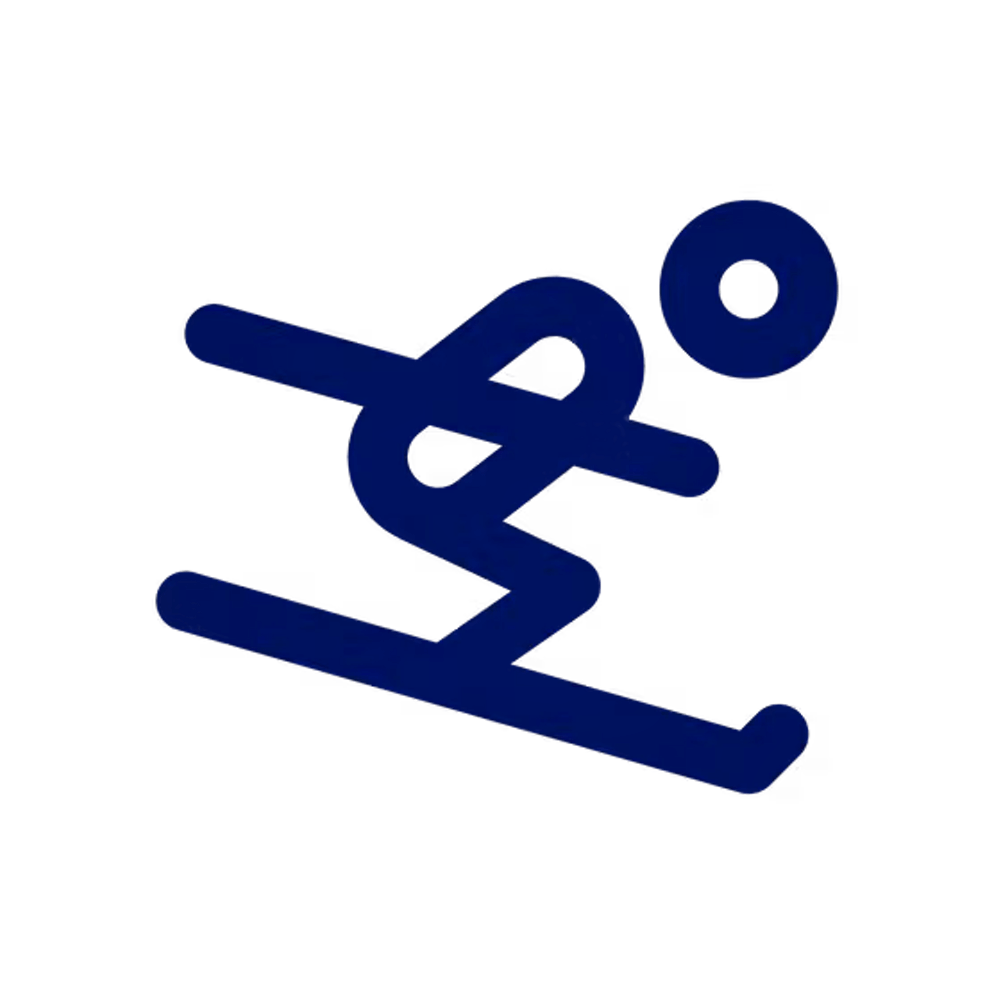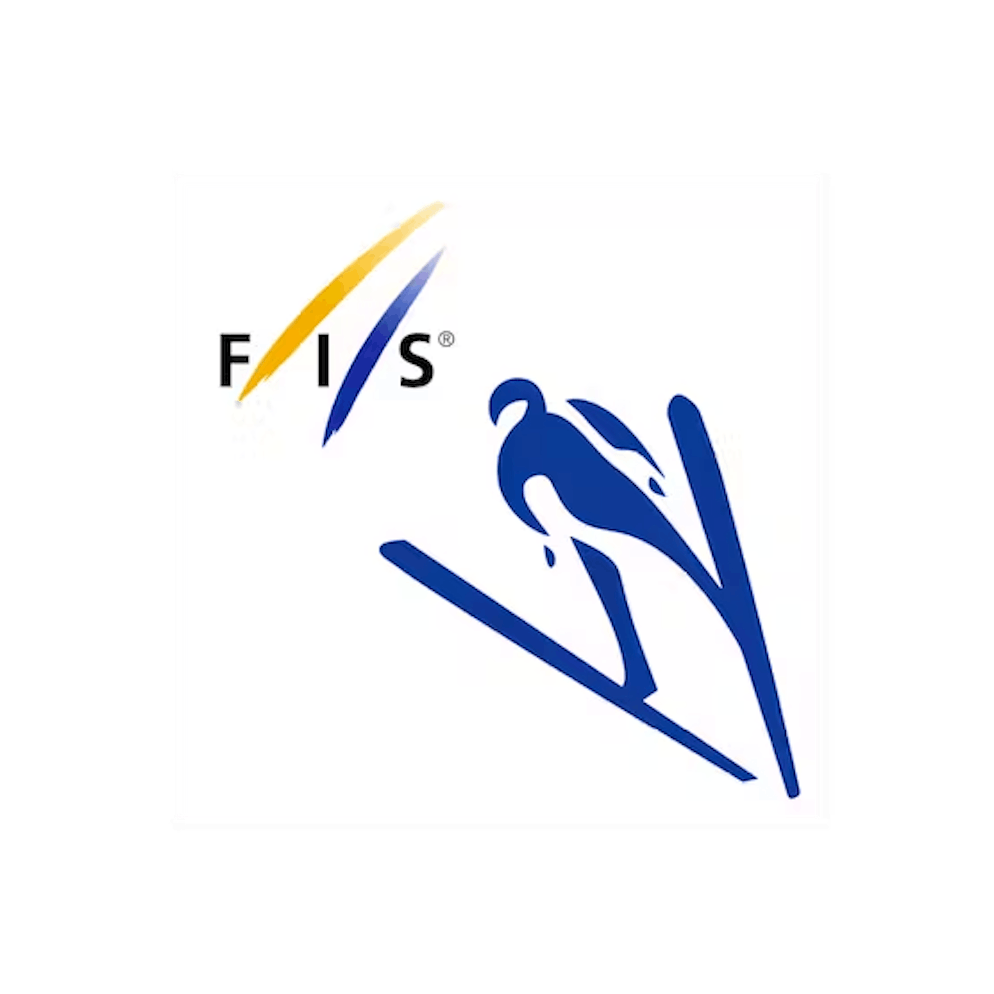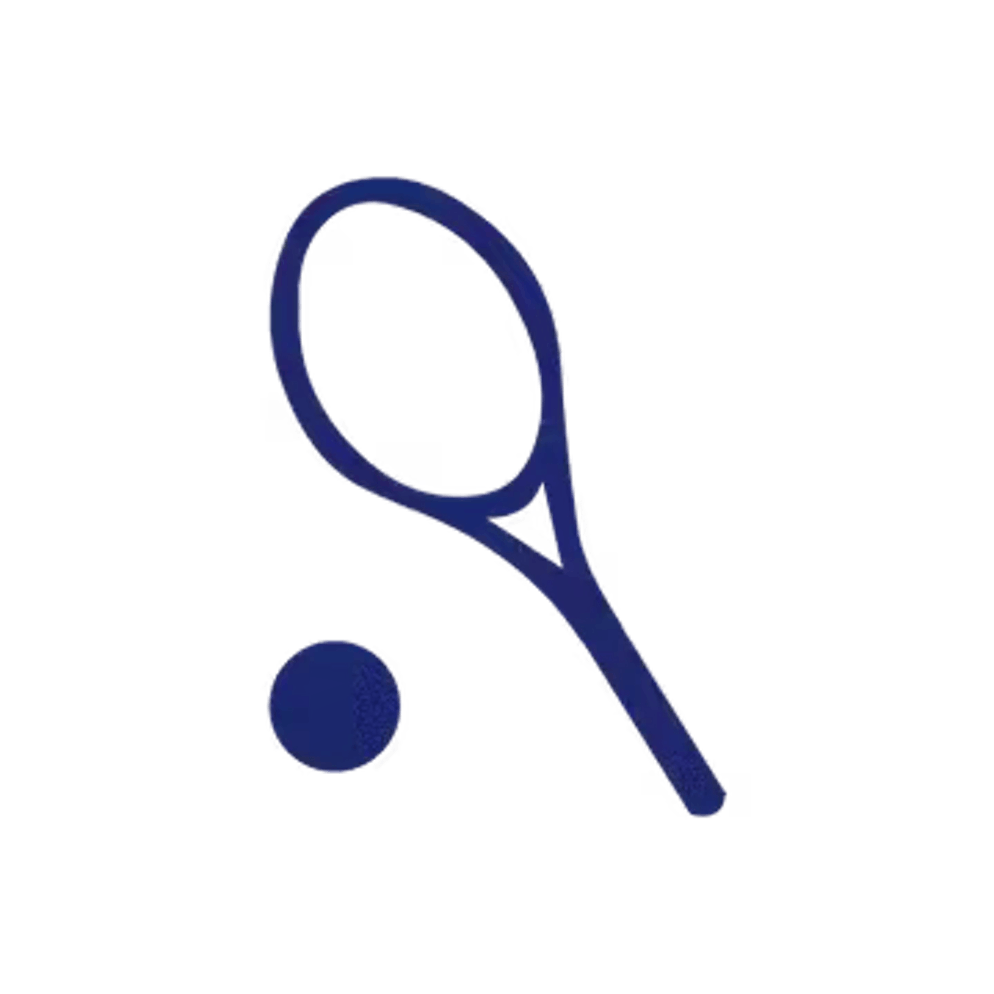De la production de céréales à l'effondrement du rouble: la directrice de la DDC Patricia Danzi a déjà en tête la deuxième onde de choc de la guerre en Ukraine. Elle explique comment la Suisse apporte son aide et comment elle négocierait avec Poutine.
Madame Danzi, le monde entier a actuellement les yeux rivés sur l'Ukraine. Vous voyagez souvent dans des zones de crise et de guerre: cela vous endurcit-il ?
Je suis aussi un être humain. Quand on a déjà été sur des théâtres de guerre, on peut deviner tout ce qui se passe en coulisses: problèmes mentaux, coups du sort, traumatismes. Cela me touche de près. Mais pour moi, il s'agit en même temps de mettre en place une réponse professionnelle à cette crise: clarifier ce qui peut être fait et organiser les gens. Pour cela, il faut une certaine distance et une pensée claire. Mais ces deux points de vue ne peuvent pas être strictement séparés.
Alors que les combats font rage, que pouvez-vous préparer ?
La DDC peut fournir une aide humanitaire très rapidement, surtout au début d'une crise. Une aide efficace en cas de catastrophe est un point fort de la Suisse. Nous avons déjà effectué plusieurs livraisons d'aide dans la région, en Ukraine et dans les pays voisins, y compris jusqu'à Kiev. Outre l'aide humanitaire d'urgence, il s'agit également de changer de programme. La Suisse est active depuis longtemps en Ukraine dans le cadre de la coopération bilatérale au développement, la DDC et le Seco y collaborent. Il s'agit par exemple de l'approvisionnement en eau et en soins médicaux. Nous devons justement réorganiser beaucoup de choses avec nos partenaires sur place pour adapter les programmes aux circonstances, enseigner la médecine de guerre en ligne, remettre en service d'anciens puits, mettre en route la planification de l'hébergement des personnes déplacées à l'intérieur du pays, par exemple.
Des employés de la DDC sont-ils encore actifs sur place ?
L'ambassade de Suisse et notre bureau de coopération à Kiev ont été temporairement fermés. Certains de nos employés ont quitté le pays, d'autres ont décidé de rester. L'équipe continue toutefois de travailler et ses missions sont réorganisées.
À propos de Patricia Danzi

Dr
Patricia Danzi est à la tête de la Direction du développement et de la coopération (DDC) depuis 2020. Auparavant, elle a travaillé de longues années pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), notamment dans les Balkans, au Pérou, en République démocratique du Congo et en Angola. En tant qu'athlète, Danzi a représenté la Suisse aux Jeux olympiques d'été de 1996.
La guerre a d'immenses répercussions sur le pays et les gens. Quel est l'aspect qui vous préoccupe le plus ?
Le fait que le droit international humanitaire ne soit pas respecté. Des hôpitaux sont bombardés, des combats ont lieu à proximité de centrales nucléaires, la population civile est empêchée de fuir. Et ce, bien que les armées impliquées connaissent très précisément le droit de la guerre et que l'un des belligérants soit représenté en tant que membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le droit international ne s'impose pas comme ça. On peut et on doit toujours faire des appels. L'ensemble de la communauté internationale doit toujours thématiser le respect et l'observation du droit international humanitaire. Ce ne sont pas des paragraphes vides de sens, derrière eux se trouvent des personnes qui ont droit à une protection, des blessés qui doivent être soignés dans des hôpitaux, des prisonniers de guerre qui doivent être traités avec respect. Il ne faut jamais l'oublier.
La situation actuelle nécessite-t-elle encore d'autres aides ?
Oui, surtout pour ceux qui ne peuvent pas fuir l'Ukraine. Plusieurs villes sont encerclées, sans infrastructure stable d'électricité ou d'eau. Les gens manquent de biens pour couvrir leurs besoins de base. Mais l'acheminement de l'aide dans ces villes est difficile.
La DDC a-t-elle déjà pu effectuer des livraisons avec succès ?
La Suisse livre des biens de secours dans les pays limitrophes, d'où ils sont distribués en Ukraine par des organisations partenaires locales. L'aide atteint ainsi les personnes qui en ont besoin, même si ce n'est pas aussi facile dans toutes les villes. Marioupol, par exemple, n'est guère accessible en ce moment. Mais il ne faut pas oublier: La population civile s'aide aussi elle-même. Les gens n'attendent pas passivement que l'aide extérieure arrive, et le gouvernement travaille sans relâche. Il y a par exemple toujours des pompiers et des policiers qui fonctionnent. La Suisse a contribué pendant des années à mettre en place des structures et à renforcer les systèmes, même décentralisés. Cela a porté ses fruits.
Peut-on déjà se faire une idée de l'ampleur des conséquences de cette guerre ?
Cela dépend de la durée de la guerre. Mais elle a déjà eu un impact massif sur les pays voisins en très peu de temps. D'une part, par les réfugiés qui se dirigent vers l'ouest. Du point de vue suisse, c'est la conséquence la plus évidente de la guerre. Les pays d'Asie centrale, dont de nombreux travailleurs immigrés viennent travailler en Russie, sont également immédiatement touchés. Leurs transferts de fonds représentent une grande partie du produit intérieur brut de l'Ouzbékistan ou du Kirghizstan - la chute de la valeur du rouble touche donc aussi ces pays de plein fouet. Les pertes de récoltes de céréales posent problème au Moyen-Orient, au Yémen ou au Liban. Tous ces aspects ne sont pas encore au centre de nos préoccupations. Mais nous essayons de les prendre en compte dans notre planification.
Et quelles sont les conséquences pour l'Ukraine elle-même ?
Selon une étude, des infrastructures d'une valeur de neuf milliards de dollars ont été détruites en l'espace de deux semaines. Cela peut être reconstruit, mais il s'agit tout de même de sommes immenses, et il faut d'abord réunir cet argent. Ce qui n'est pas facile à reconstruire, ce sont les gens. Des familles sont déchirées lorsque le père ne peut pas passer la frontière parce qu'il doit se battre. Les femmes risquent d'être victimes de violences sexuelles ou de la traite des êtres humains, il y a beaucoup de morts et de blessés, beaucoup de gens sont témoins de scènes de guerre qu'ils n'auraient jamais imaginées et vivent des moments de peur de la mort. Plus la guerre dure, plus ces traumatismes sont nombreux - cela peut influencer des générations entières. Nous n'en sommes pas encore là en Ukraine, mais le risque d'un conflit prolongé existe malheureusement, nous ne savons pas comment la situation va évoluer.
Qu'en est-il de la future relation entre les Ukrainiens et les Russes ?
Les liens entre les deux pays sont très étroits, de nombreuses familles ont des membres des deux côtés. Les distorsions peuvent tout à fait être réparées, comme le montrent les expériences d'autres guerres. Mais ce processus doit être accompagné, les crimes de guerre doivent être traités. Les victimes doivent avoir le sentiment d'obtenir une satisfaction - c'est alors qu'une réconciliation peut réussir.
L'UDC demande que les réfugiés soient aidés en priorité dans les pays voisins de l'Ukraine. Une approche judicieuse ?
Les gens savent eux-mêmes où ils veulent aller, où ils ont déjà une famille ou des connaissances linguistiques. Il faut laisser les réfugiés décider. Mais je suis extrêmement heureuse que la population suisse montre autant de cœur pour les Ukrainiens. C'est une condition préalable pour qu'ils se sentent les bienvenus et puissent s'intégrer - quel que soit le pays.
Le Conseil fédéral a accordé le statut de protection S aux personnes déplacées en Ukraine. Cela n'existait pas pour les personnes venant d'Afghanistan ou de Syrie. Cela montre-t-il qu'avec la volonté nécessaire, il serait possible de faire plus en matière de politique des réfugiés ?
Je trouve que le fait que le statut de protection S ait été activé pour la première fois est une bonne chose. J'espère que nous pourrons étendre à d'autres groupes de population la solidarité dont les Suisses font preuve envers les Ukrainiens. Que l'on prenne davantage conscience de ce que signifie être un réfugié. Car personne ne fuit volontairement son pays. La DDC s'est engagée depuis des années pour une solution pacifique du conflit dans l'est de l'Ukraine.
Tout ce travail a-t-il été réduit à néant ?
Pas nécessairement. Nos efforts de paix étaient et restent importants. La Suisse a été le seul pays à pouvoir acheminer de l'aide de l'Ukraine vers le Donbass, via la fameuse ligne de contact. Nous poursuivrons ces bons offices d'une manière ou d'une autre dans le cadre des différents efforts de paix. De même, nos programmes de soutien aux communes et aux organisations en Ukraine portent aujourd'hui leurs fruits - malheureusement dans des circonstances très tragiques. La situation est moins bonne pour les projets d'infrastructure que la Suisse a soutenus. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il adviendra de l'Ukraine. Pour l'instant, nous mettons l'accent sur l'aide d'urgence, l'accès et la protection de la population civile. Différents services gouvernementaux ou villes souhaitent toutefois que nos programmes soient adaptés aux conditions et poursuivis - c'est ce que nous allons faire. Nous verrons qui sera au pouvoir dans six mois ou dans un an et comment la situation se présentera alors.
Dans une interview, vous avez dit qu'avant les négociations, vous réfléchissiez à un «effet de levier», un levier sur lequel vous pourriez agir avec votre partenaire de négociation. Où serait un tel levier avec le président russe Vladimir Poutine ?
Je me rendrais certainement avec une délégation composée pour moitié de femmes.
Pour quelle raison ?
Lors des négociations de paix, il n'y a généralement que des hommes autour de la table. Je n'ai pas non plus remarqué de femmes sur les photos des discussions à Antalya en Turquie ou en Biélorussie. C'est une appréciation personnelle de ma part, mais : une guerre est une confrontation très extrême, et lorsque des hommes qui se sont fait la guerre sont assis en face les uns des autres, cette confrontation ne disparaît pas simplement. Les femmes peuvent apporter une autre perspective, celle de la souffrance de la population civile, des enfants aussi, des familles déchirées, des traumatismes, et faire ainsi vibrer une autre corde chez l'autre.
À quoi d'autre feriez-vous attention lors de négociations ?
J'essaierais de commencer par ce que l'on appelle les «easy wins». Les deux parties ont des prisonniers de guerre, on peut donc négocier un échange. Il est en outre important d'écouter. Que veut mon interlocuteur ? Quelle est sa perspective ? On peut ainsi découvrir quels compromis sont possibles. L'objectif doit être que les deux parties puissent tirer un bénéfice de la négociation - et que l'humanité soit préservée. Car plus une guerre dure, plus les blessures sont profondes. Je suis soulagée que l'on négocie encore, car c'est à la table des négociations que l'on peut mettre fin aux guerres.
Vous avez parlé des avantages en tant que femme. Y a-t-il aussi des inconvénients, par exemple avec des partenaires de négociation issus de cultures très patriarcales ?
Personnellement, je n'ai jamais vécu cela comme un problème. La plupart du temps, il y a au contraire du respect pour le fait qu'une femme mène des négociations. Les moments étranges se produisent généralement au début, lorsque je suis en déplacement avec des collègues. On pense souvent que l'homme blanc est obligatoirement le chef de la délégation. Mais après quelques secondes, le malentendu disparaît. Tout dépend du contenu des discussions.
Il y a un peu plus de six mois, le monde avait les yeux rivés sur l'Afghanistan, car les talibans s'étaient emparés du pouvoir. La journaliste allemande Natalie Amiri m'a récemment dit qu'elle n'avait jamais vu autant de famine dans le pays que maintenant. La situation est-elle vraiment aussi catastrophique ?
Malheureusement, la situation est vraiment dramatique. Après la prise de pouvoir des talibans en août, de nombreuses personnes ont perdu leurs revenus du jour au lendemain. Beaucoup ont quitté les villes pour la campagne, où le coût de la vie est moins élevé. La situation reste néanmoins très, très difficile. Par la suite, les fameuses stratégies d'adaptation reprennent le dessus : les filles sont mariées à un jeune âge, le trafic d'organes fleurit - de tristes histoires. La communauté internationale a mis en place un système parallèle pour contourner le gouvernement de transition des talibans.
Qu'entendez-vous par là ?
La Suisse reconnaît les Etats, pas les gouvernements. Le gouvernement de transition des talibans n'a encore été reconnu par aucun Etat. Le dilemme auquel sont confrontés de nombreux pays - dont la Suisse - est que l'on cherche un moyen de soutenir la population, en contournant le gouvernement de transition. Cela conduit à ce que des organisations non gouvernementales comme le Comité international de la Croix-Rouge ou l'ONU se substituent à l'État pour couvrir les besoins de base de la population, par exemple dans le domaine de la santé. C'est faisable à court et moyen terme, mais pas durablement.
La Suisse a fermé son bureau à Kaboul ...
... temporairement.
... mais cela fait déjà plus de six mois. Comment la Suisse soutient-elle la population afghane ?
Nous avons obtenu fin 2021 un crédit supplémentaire de 33 millions de francs, avec lequel nous pouvons soutenir des organisations internationales et locales. Et parmi les programmes que nous avons menés avec des partenaires dans le pays, nous n'avons dû en arrêter que quatre, 20 continuent sous une forme adaptée aux circonstances. Il s'agit ici de l'agronomie et de la préparation du pays aux conséquences du changement climatique. Ces thèmes restent importants, quel que soit le pouvoir en place. Ce qui est en revanche devenu plus difficile sous les talibans, ce sont les programmes sur les droits de l'homme. Il faut toujours rappeler aux talibans que le respect des droits de l'homme et l'inclusion resteront des thèmes centraux, sur lesquels ils seront jugés.
L'Afghanistan a été généreusement soutenu par l'étranger pendant 20 ans, et pourtant le pays se porte si mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui a mal tourné ?
Il y a des succès, les programmes d'éducation par exemple ont eu un effet certain. Si l'on enseigne quelque chose aux gens, ce savoir ne se perd pas simplement parce que le gouvernement change. Mais il y a aussi eu des erreurs. Le fait que la population afghane n'ait pas toujours été suffisamment écoutée sur ses besoins - dans les régions rurales notamment, les traditions sont plus fortement enracinées. Le gouvernement avant le changement de pouvoir des talibans n'a pas directement soutenu la Suisse. Il y avait divers problèmes de gouvernance.
Pouvez-vous les nommer plus concrètement ?
Des accusations de corruption. C'est pour cette raison que nous ne travaillions pas directement avec l'ancien gouvernement, mais avec des organisations partenaires. Actuellement, nous vivons une crise après l'autre, ce qui fatigue beaucoup de gens.
Pour vous, c'est le quotidien : cela ne vous pèse-t-il pas ?
Dans ce métier, il faut certainement rester à la fois optimiste et réaliste, chercher et voir le bon côté des choses. Même dans une guerre, on découvre toujours l'humanité et la solidarité. Tant que cela existe, il y a de l'espoir - et cela nous motive.